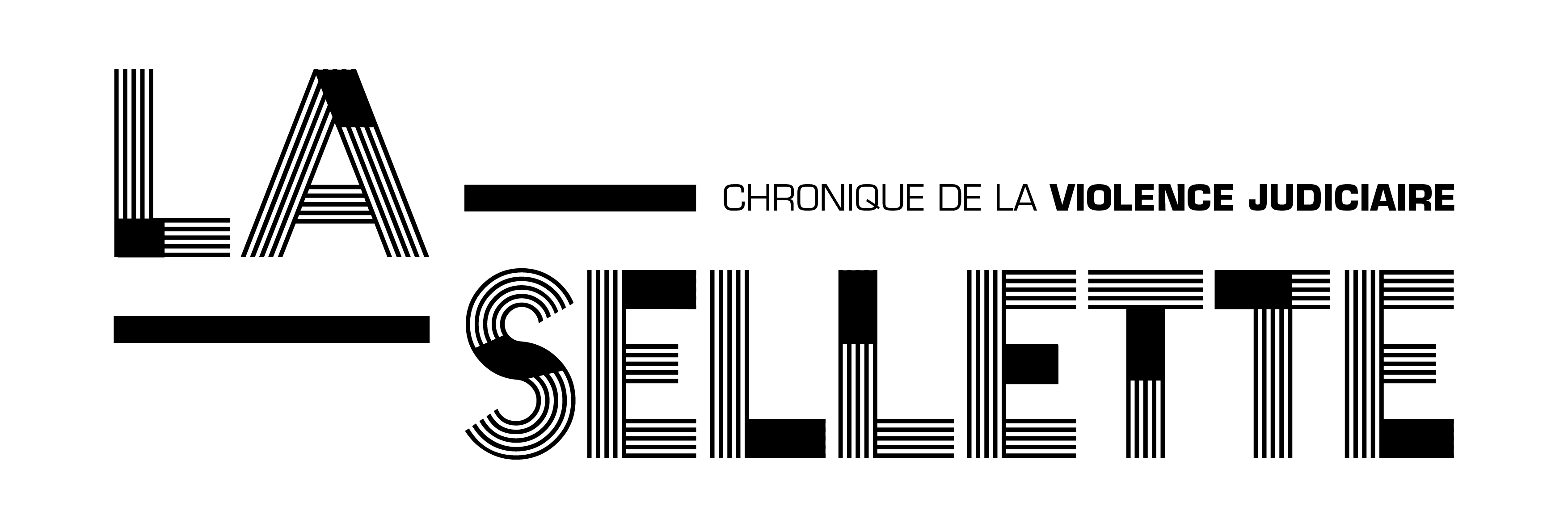Protéger la société
Toulouse, chambre des comparutions immédiates, juillet 2024
Nicolas P. est accusé de violences volontaires sans interruption totale de travail (ITT) sur sa compagne et de menaces de mort réitérées.
La présidente résume les faits : les policiers ont été appelés par un ami du couple, paniqué, expliquant que Nicolas P. avait annoncé qu’il allait tuer tout le monde.
— Effectivement quand les policiers sont arrivés, ils ont constaté que vous étiez en pleine crise. Au commissariat, votre compagne a raconté que vous avez commencé par saisir un couteau pour vous trancher la gorge. Elle s’est interposée et c’est là qu’il y a eu des coups.
Le prévenu explique n’en avoir aucun souvenir. La présidente continue :
— L’expertise psychiatrique indique que vous avez été hospitalisé à de nombreuses reprises depuis vos 18 ans. Est-ce que vous vous soignez ?
— Actuellement je suis en rupture de traitement. J’ai été obligé de me sevrer lors de ma précédente peine de prison parce que je me faisais racketter : le médicament que je prenais était un dérivé d’amphétamine.
— Mais est-ce que vous l’avez signalé au moins ?
— Je l’ai dit au médecin. Il m’a répondu qu’on allait essayer de s’en passer. En sortant, j’ai voulu reprendre, mais je n’ai pas réussi à me faire prescrire le traitement.
Le prévenu décrit précisément toutes les démarches entreprises pour être suivi à nouveau avant de conclure :
— J’ai enfin trouvé un médecin psychiatre après de nombreux mois de recherches. Et j’ai rendez-vous en septembre au centre médico-psychologique Marengo.
La présidente parcourt les six mentions du casier judiciaire, toutes en rapport avec des épisodes de crise :
— Violences sur dépositaire de l’autorité publique, rébellion, outrage, refus de se soumettre au test sur les stupéfiants, conduite sous stupéfiant. Qu’est-ce que c’était comme drogue ?
— Du cannabis.
— Alors que vous avez cette pathologie, vous prenez quand même des drogues ! Sans compter que vous savez que vous avez des problèmes graves et vous ne vous soignez pas ! Est-ce que ce n’est pas de la dangerosité sociale, ça, monsieur ?
Elle poursuit :
— Vous êtes sous curatelle, vous recevez l’allocation adulte handicapé, vous avez un enfant de 3 ans et demi, qui est à la charge de sa mère. Dans son expertise, le psychiatre estime qu’il n’y a ni abolition ni altération du discernement. Il vous a diagnostiqué un trouble borderline. Vous faites preuve d’une violence structurelle quand vous êtes non traité !
Une nouvelle fois, le prévenu affirme vigoureusement qu’il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour se soigner. Qu’il a besoin d’avoir le bon traitement, d’être soigné correctement. Qu’un passage en prison réduirait à néant le travail déjà effectué pour être pris en charge et reprendre une vie normale :
— Le SPIP et tous les psychologues et psychiatres que j’ai vu⋅es peuvent confirmer que j’ai fait le maximum. Je ne cherche qu’à me réinsérer.
— Vous n’avez pas réussi, dites-vous – même si on ne comprend pas tout à fait pourquoi –, à reprendre le traitement. Mais nous, magistrats, sommes professionnellement responsables de l’évaluation de votre situation et de votre dangerosité.
Sur quoi elle invite la compagne du prévenu à s’avancer à la barre pour témoigner, tout en précisant que le tribunal ne remet pas en cause le fait que Monsieur souffre de problèmes graves.
La jeune femme est très ferme :
— J’ai une première chose à dire : je n’ai jamais dit qu’il m’avait frappé volontairement et ça n’est jamais arrivé. Il m’a saisie à la gorge quand je me suis interposée entre lui et le couteau.
Elle confirme aussi que son compagnon et elle ont appelé de nombreux psychiatres et tous les centres médicaux psychologiques pour qu’il puisse récupérer son dossier et son traitement.
La présidente n’apprécie pas ses précisions :
— Vous dites ça aujourd’hui mais il y a quand même des photos qui montrent dans quel état vous étiez…
— Je sais dans quel état j’étais. Les hématomes proviennent de la bousculade, ce n’était pas volontaire.
— Bon, comment est-ce que vous voyez la suite ?
— Je veux qu’il obtienne son traitement, qu’il soit stabilisé, même si je ne veux pas minimiser les faits.
La présidente traduit d’un air réprobateur :
— On comprend que vous n’envisagez pas une séparation et que vous ne vous constituez pas partie civile.
La procureure partage l’agacement de la présidente :
— Madame a du mal à se considérer comme une victime parce qu’elle se focalise sur le trouble psychiatrique de monsieur. Or ces faits restent condamnés par la loi. Ils ont été commis en récidive légale alors que monsieur a déjà plusieurs condamnations. Des peines alternatives telles que le sursis probatoire ont été essayées, mais ça ne l’a pas pour autant empêché de recommencer. Le psychiatre a diagnostiqué une dangerosité ainsi qu’un trouble psychiatrique, ce qui ne l’empêche pas d’être intégralement responsable des faits commis, comme le dit le même expert psychiatre, qui n’a reconnu ni abolition ni altération du discernement.
Elle propose une peine de 8 à 10 mois de prison et le maintien en détention. Puis, comme si elle n’avait rien entendu de ce que Nicolas P. avait pu dire :
— Le prévenu n’est pour l’instant pas en capacité d’entendre qu’il doit se soigner. Or nous devons protéger la société. Par ailleurs, seule une détention pourra permettre de stabiliser son état.
L’avocate se lève pour sa plaidoirie :
— La société doit répondre des défaillances dans la prise en charge. La SPIP responsable du suivi du sursis probatoire renforcé a rendu un rapport en juin dernier au juge d’application des peines. Ce rapport éclaire beaucoup sur la personnalité du prévenu et sur les efforts faits pour reprendre son traitement. À plusieurs reprises, il est venu la voir en disant : « Je ne sais plus quoi faire, je ne vais pas bien. » La rupture du traitement, ce n’est pas parce qu’il n’a pas conscience de sa situation. Le neuroleptique qu’il doit prendre n’est prescrit que quand il y a un suivi très serré qui est mis en place. Or le psychiatre qui le suivait initialement n’a pas transmis son dossier. À son niveau, il a fait tout ce qu’il pouvait. On lui reproche d’être en rupture de soin, c’est injuste. Et ce n’est pas en prison qu’il aura le traitement dont il a besoin. Aucun psychiatre ne prendra cette responsabilité dans le cadre d’une incarcération parce qu’il y aura encore du racket.
Sa plaidoirie finie, elle remet des documents à la présidente « et une lettre de sa maman qui explique quel genre de garçon c’est ».
Le dernier mot est au prévenu, en pleurs :
— Je suis désolé pour le désagrément que mes proches ont subi. Je suis désolé pour ma mère. Je n’ai jamais arrêté les efforts. Je voudrais une sanction adaptée à ma situation.
Il est condamné à 6 mois de prison et maintenu en détention ainsi qu’à un suivi sociojudiciaire pendant 3 ans, comprenant une injonction de soins avec un an de prison à la clé en cas de non-exécution. Pour justifier la peine, la présidente parle encore de « vraie dangerosité sociale » et indique que cette sanction est la seule manière d’être sûr qu’il soit correctement pris en charge. Elle conclut d’un air satisfait :
— Et, à votre sortie, un médecin coordonnera votre parcours médical via le juge d’application des peines.