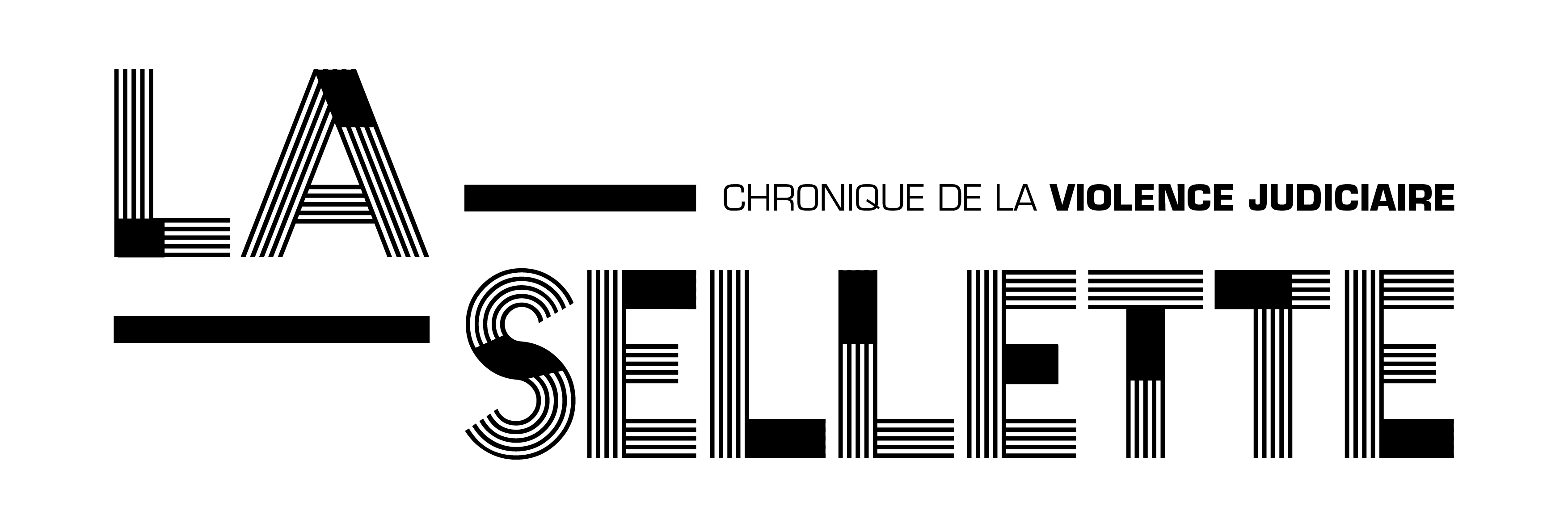Sur le même sujet, on peut aussi écouter notre chronique dans la rubrique Audio.
Tout au long de la procédure pénale, la personne mise en cause peut être assistée par un⋅e interprète. Ce droit est aujourd’hui reconnu tant par le code de procédure pénale que par la Convention européenne des droits de l’homme, qui en fait une composante essentielle d’un procès équitable.
Un tel droit relève à priori du bon sens : la personne confrontée à la justice doit comprendre ce qu’il se passe pour pouvoir se défendre, de la même manière que la justice doit comprendre les réponses qui lui sont données. La présence de l’interprète est également prévue lors des entretiens confidentiels avec l’avocat⋅e. Comme nous le dit l’une d’entre elles :
En garde à vue et juste avant l’audience de comparution immédiate, on a peu de temps et on doit expliquer la procédure, parler de ce qu’il y a dans le dossier, poser des questions sur la situation personnelle de la personne, envisager une défense, évoquer le risque d’incarcération… les enjeux sont importants et on ne peut pas se contenter d’une compréhension approximative.
Dans ces conditions, le rapport que l’interprète entretient avec la police, les magistrat⋅es et la personne poursuivie, ainsi que la qualité de sa prestation sont déterminants. Pourtant, pour seule garantie éthique, la loi prévoit qu’il ou elle doit prêter serment « d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience ».
Si les notions d’« honneur » et de « conscience » sont pour le moins nébuleuses, on comprend qu’il revient à l’interprète de traduire fidèlement les propos tenus et uniquement ceux-ci, et de s’astreindre à une neutralité envers l’institution et la personne mise en cause. L’interprète doit être transparent⋅e et rendre transparent pour le ou la prévenu⋅e ce qu’il se passe à l’audience, de manière à placer – théoriquement – la personne ne maîtrisant pas le français dans la même situation que celle le parlant couramment.
Avant l’audience, un droit mis en œuvre par la police
La personne mise en cause a, dès son placement en garde à vue, le droit de demander un⋅e interprète. Encore faut-il qu’elle comprenne ce droit. Un formulaire doit lui être remis le mentionnant dans une langue qu’elle comprend. Outre le fait que ces formulaires n’existent pas dans toutes les langues, comment celui ou celle qui ne sait pas lire peut avoir connaissance de son droit ?
Dans la pratique, c’est l’officier de police judiciaire en charge de la garde à vue qui appréciera le niveau de compréhension de la langue de l’individu. Or, si l’article préliminaire du code de procédure pénale prévoit que la personne suspectée qui ne comprend pas la langue française a droit à un⋅e interprète, dans les faits, une autre question préside au choix de requérir ou non cette assistance : la personne comprend-t-elle suffisamment le français pour qu’on puisse s’en passer ?
Aucun critère d’évaluation du niveau de compréhension de la langue n’a été pensé, on s’en remet donc à la subjectivité des enquêteurs.
Si la personne mise en cause demande à être assistée d’un avocat lors de sa garde à vue, ce dernier peut solliciter l’intervention d’un⋅e interprète. Même si un officier de police a pu estimer que cela n’était pas nécessaire, il acquiescera le plus souvent à une demande qui, si elle n’était pas satisfaite, pourrait fragiliser la procédure.
Mais qui appellera-t-il ?
Il peut requérir un expert agréé par la cour d’appel. Ce dernier aura dû justifier de compétences particulières, de diplômes, même si les associations d’interprète déplorent régulièrement le manque de contrôle de ces qualifications et l’absence de formation spécifique obligatoire. À défaut, une autre liste est à sa disposition, cette fois dressée par le procureur de la République. Pour y figurer, aucun diplôme particulier n’est exigé.
De toute façon, la loi prévoit que, en cas de nécessité, l’officier peut tout aussi bien requérir une personne ne figurant sur aucune de ces listes, du moment qu’il estime que ses compétences sont suffisantes. Seule limite : il ne pourra pas désigner un⋅e de ses collègues, un⋅e magistrat⋅e ou un⋅e greffier⋅e…
Après tout, la personne ainsi requise ne prête-t-elle pas serment d’apporter son concours en « honneur et conscience » ?
Depuis plusieurs années pourtant, la presse se fait l’écho de pratiques étonnantes. Le Canard enchaîné révélait ainsi en 2014 le cas d’un interprète en « anglais, italien, espagnol, russe, arabe, polonais, chinois », ayant passé des années « à baragouiner d’effarantes sottises » jusqu’à ce que l’on s’aperçoive tardivement qu’il n’y entendait rien[1].
Outre l’éventuel problème de compétences, l’officier aura naturellement tendance à appeler quelqu’un qui se rend régulièrement disponible, quelqu’un avec lequel il aime travailler. De fait, il n’est pas rare que l’interprète choisi⋅e soit un⋅e ami⋅e, un⋅e membre de sa famille, un⋅e conjoint⋅e de collègue. Et la proximité des interprètes avec les policiers pose évidemment question pour les droits du ou de la mis⋅e en cause. Un expert-interprète explique par exemple au Canard enchaîné que cette « armada d’amis des policiers […] n’hésite pas entre autres à conseiller au gardé à vue de renoncer à un avocat, ou bien à l’inciter à parler en lui jurant que ça va l’aider ».
Même quand un interprète n’est pas proche de la police, sa situation économique risque de le mettre en position délicate. Il exerce souvent cette activité en tant qu’auto-entrepreneur[2] et peut rapidement se retrouver dans une situation de dépendance économique par rapport à celui qui décide de faire appel à lui. D’autant plus que, pour certaines langues, la concurrence est rude. Il lui faudra alors se montrer disponible et répondre à toutes les attentes. Et certains enquêteurs n’hésitent pas à faire de lui un auxiliaire de police. Ainsi, un interprète témoigne dans une enquête réalisée en 2012 : « Des fois au commissariat, il arrive qu’un policier demande d’où vient le gardé à vue, si je trouve qu’il ment, si son accent correspond à la nationalité indiquée[3]. »
S’il refuse, sera-t-il rappelé ?
L’enjeu est important pour lui car à Toulouse par exemple, l’interprète présent⋅e lors de la garde à vue sera appelé⋅e par le parquet pour assurer l’interprétation à tous les stades de la procédure, et finalement devant la chambre des comparutions immédiates.
Ainsi, comme souvent en comparution immédiate, les décisions policières auront des conséquences tout au long de la procédure et il sera difficile de revenir en arrière.
Trop souvent, des avocat⋅es amené⋅es à intervenir après une garde à vue sans interprète et l’estimant nécessaire doivent l’imposer au moment du déferrement devant le procureur, quitte à agacer. Une avocate explique :
Il faut alors voir le parquetier de permanence pour exiger qu’on fasse appel à un interprète et il arrive bien souvent qu’il s’étonne : « Il a besoin d’un interprète ? Pourquoi n’en a-t-il pas eu besoin en garde à vue ? Il ne comprend plus ?» Le soupçon est là, le prévenu ferait semblant de ne pas comprendre.
Plus prosaïque un avocat concède : « Exiger un interprète c’est aussi accepter d’attendre des fois plusieurs heures que quelqu’un arrive, et tout ça pour la même rémunération. Alors des fois on hésite. »
À l’audience, une présence encombrante
Lorsqu’il ou elle doit intervenir lors d’un procès, l’interprète est avisé⋅e de la date d’audience et invité⋅e à se présenter seulement au début de celle-ci. En pratique, le rythme imposé par la procédure de comparution immédiate peut mettre à mal les droits de la défense, relève une avocate :
Le problème, c’est qu’on a forcément besoin de rencontrer la personne avant. Or l’interprète arrive au début de l’audience. La justice le rémunère à l’heure et le tribunal voudra évoquer les dossiers avec interprète en priorité pour le libérer au plus vite. On doit donc aller voir l’huissier pour demander de prendre un autre dossier avant, de manière à ce que l’interprète puisse nous accompagner aux geôles pour avoir un entretien avec le prévenu. Cela peut créer des tensions, car ça bouleverse l’ordre de passage que le tribunal avait prévu. Et puis ce sont des dossiers qui prennent nécessairement plus de temps, alors le président veut les évacuer au plus vite. Il faut oser s’imposer, ce qui peut crisper.
Et si l’interprète ne vient pas ? Un⋅e autre devrait être appelé⋅e ou l’affaire renvoyée. Pourtant un travail d’observation mené à la Cour d’appel de Paris en 2008 relevait que certaines audiences ont été maintenues, les magistrats estimant finalement que le prévenu comprenait « suffisamment » le français.
Etait-ce le cas ? Ou s’agissait il surtout de ne pas plus retarder une organisation déjà engorgée ?: Il aurait fallu en appeler un⋅e en urgence et l’attendre, parfois longtemps.
La réticence à appeler faire venir un interprète à l’audience est plus forte quand il n’y en a pas eu aux étapes précédentes, parce que c’est toute la procédure qui pourrait être annulée. Certains moments d’audience illustrent ce malaise :
— Il ne parle pas français ?
Le président demande au prévenu de confirmer son adresse. On comprend mal la réponse. L’assesseuse à sa gauche, une femme de cinquante ans, se penche pour demander au président à voix basse :
— Si, mais…
Il ne termine pas sa phrase, visiblement gêné. Aucun interprète n’a été prévu.
Après un court moment de flottement, il reprend l’interrogatoire du prévenu comme si de rien.
(Extrait de « Vous étiez là depuis le début ? ».)
En 2008, Serge Portelli, ancien président de chambre des comparutions immédiates, reconnaissait lui-même un certain laxisme des magistrats dans la mise en œuvre du droit à un⋅e interprète : « Ça donne dans les audiences des dialogues incertains, improbables, avec des personnes qui ne comprennent qu’à moitié ce qu’ils sont en train de vivre[4]. »
Mais cette désinvolture n’est pas le fait des seul⋅es magistrat⋅es. Si l’on se rend compte à l’audience que la personne mise en cause ne comprend que très peu ce qu’il se passe, c’est aussi que son avocat⋅e, censé⋅e pourtant l’avoir rencontrée avant, n’a pas soulevé la difficulté.
Une fois arrivé⋅e à l’audience, l’interprète devra trouver sa place. Les salles ne sont pas adaptées et, depuis la généralisation des box partiellement vitrés, les interprètes sont rarement à côté de la personne qu’ils doivent assister. Et ces dernières années covidesques, le port du masque n’a fait que rendre la situation plus compliquée :
Une interprète s’avance pour traduire l’échange entre les prévenus et la présidente. Comme c’est l’usage, elle n’est pas au côté des prévenus mais au-dessous du box, et les deux hommes doivent se pencher par-dessus le plexiglas pour entendre ce qu’elle chuchote à toute vitesse. La communication, déjà difficile d’ordinaire, est plus entravée encore par le port du masque.
La présidente, qui a du mal à comprendre, s’agace rapidement :
— Il faut changer l’installation, je n’entends rien à ce que vous dites.
La jeune femme s’éloigne donc du box pour s’installer au pupitre équipé d’un micro placé en face de l’estrade où siège le tribunal.
(Extrait de « Comment pouvez-vous évacuer complètement la possibilité qu’ils disent la vérité ?»)
Par ailleurs, la présence de l’interprète ralentit nécessairement une procédure pensée pour être la plus rapide possible et alourdit une audience souvent déjà surchargée. La patience – souvent toute relative – du tribunal envers le ou la prévenu⋅e s’en trouvera plus rapidement épuisée.
Des traductions aléatoires
Même quand la présence d’un⋅e interprète est acquise, ça peut être la qualité de la traduction qui pose problème. « Je suis bilingue en arabe et il n’est pas rare que je hurle quand je m’aperçois que l’interprète traduit n’importe quoi », rapportait un avocat au Canard enchaîné[5].
Et trop souvent, on voit l’interprète abréger ce que le prévenu dit. Quand par exemple, pour répondre à une question, un prévenu s’exprime pendant plusieurs dizaines de secondes et que pour toute traduction l’interprète se contente d’un « oui ». Qu’a-t-il exactement été dit ? On n’en saura pas plus et les magistrats rappelleront rarement à l’interprète qu’il serait souhaitable de traduire toutes les explications du prévenu. Il y a d’autres affaires à traiter et il faut que l’audience avance.
Plus généralement, il est remarquable de constater que de larges parties de l’audience ne sont pas traduites. Le serment d’apporter son concours en « honneur et conscience » ne renseigne pas beaucoup l’interprète sur ce qu’il ou elle doit effectivement faire. La loi est muette et le tribunal ne donne aucune consigne. La plupart du temps, outre le rappel des faits pour lesquels le ou la prévenu⋅e comparaît, l’interrogatoire du juge est le seul moment où l’interprète intervient : ni la plaidoirie de la partie civile, ni les réquisitions du procureur, ni la plaidoirie de la défense ne sont traduites.
Quand bien même un interprète voudrait tout traduire, il se heurterait à une autre difficulté : qu’ils soient avocat⋅es ou magistrat⋅es, les gens de justice n’adaptent pas leur langue ni leur débit à la situation. Ils ne marquent aucune pause dans leurs discours, qui laisseraient le temps à l’interprète de transposer leurs propos. Si bien que l’interprète doit maîtriser le difficile exercice de la traduction simultanée pour espérer traduire leurs interventions. Or tous les interprètes ne maîtrisent pas la technique du « chuchotage » (à savoir la traduire en temps réel à voix basse), qui demande des compétences rares.
Par ailleurs, en serait-il capable, il faudrait encore que l’interprète réussisse l’exploit de tout traduire sans déranger le tribunal. Une experte se souvient avoir été rabrouée par le président alors qu’elle s’astreignait à traduire méticuleusement tous les propos : « On ne s’entend plus ! »
Dans ces conditions, ce droit à l’interprète de la personne poursuivie ne semble plus être là que pour permettre un interrogatoire à minima. La personne jugée, après avoir répondu aux questions, assistera donc à la suite de son procès sans comprendre un traître mot de ce qu’il s’y dit, que ce soit contre ou pour elle. Pourtant, comme c’est la procédure, on lui demandera tout à fait sérieusement, une fois la plaidoirie de la défense terminée : « Avez-vous quelque chose à ajouter à ce que vient de dire votre avocat ? » Elle peut bien dire ce qu’elle veut, elle aura été assistée d’un⋅e interprète et la justice lui aura fait bénéficier d’un procès « équitable », selon ses propres termes…
[1] Dominique Simonnot, « Les mauvaises langues des interprètes judiciaires », Le Canard enchaîné, 9 avril 2014.
[2] Ces interventions sont rétribuées 42 € la première heure et 30 € les suivantes. Les 12 € supplémentaires de la première sont censés couvrir les frais de déplacement.
[3] Jérôme Pélisse, Caroline Protais, Keltoume Larchet, Emmanuel Charrier, Des chiffres, des maux et des lettres, Armand Colin, 2021.
[4] Serge Portelli, « La comparution immédiate », 2008, sur Criminocorpus.org.
[5] Dominique Simonnot, « Les mauvaises langues des interprètes judiciaires », Le Canard enchaîné, 9 avril 2014.