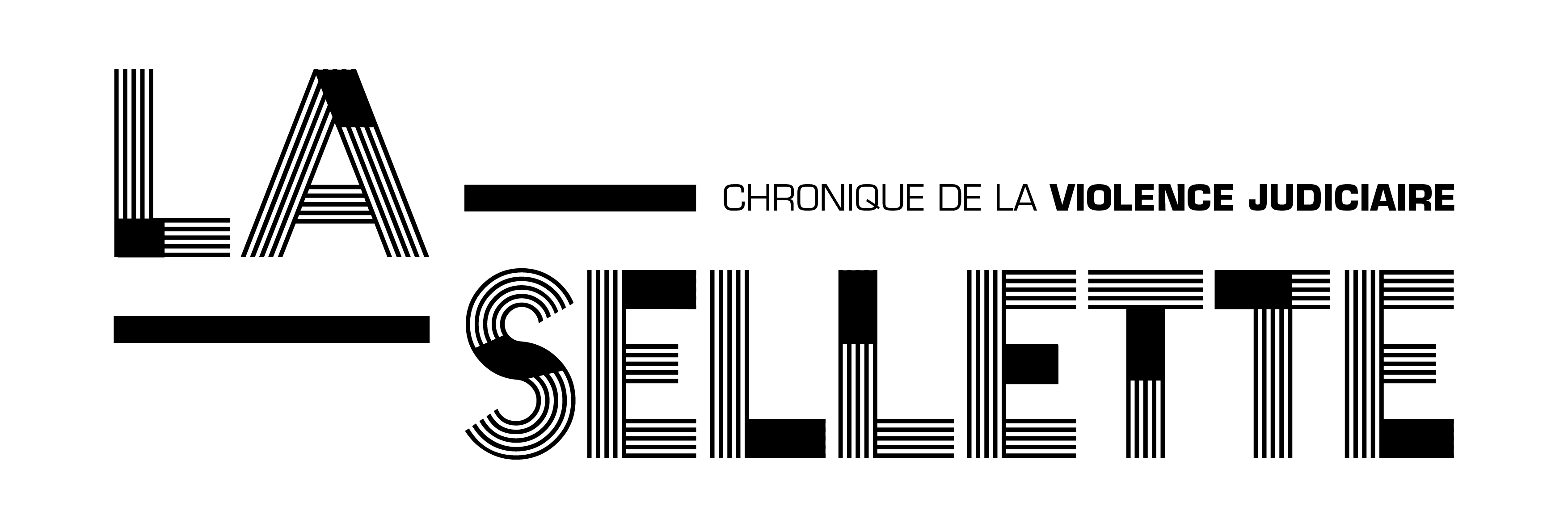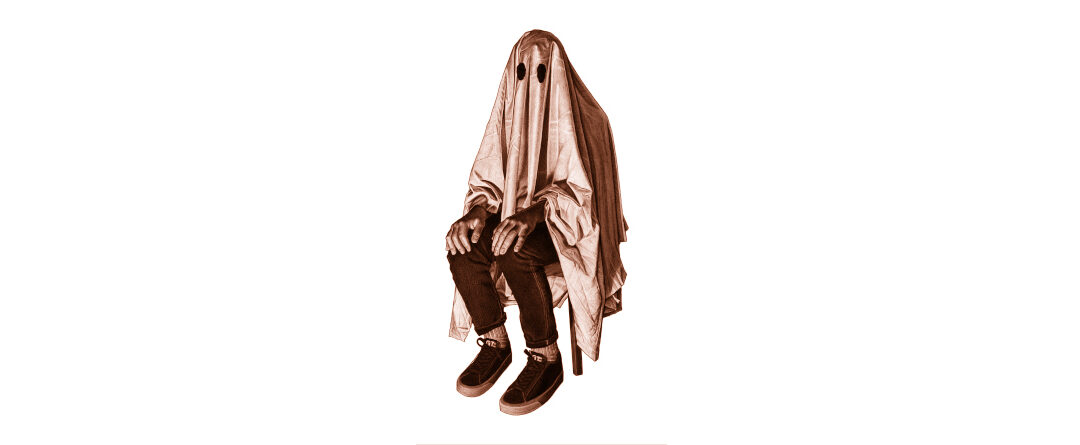
Vous êtes persécuté·e ? Prouvez-le !
Alors que la figure de l’immigré fait office de bouc émissaire dans les médias et dans les discours politiques, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) vient d’ouvrir une annexe à Toulouse, à l’automne 2024. L’occasion de se rendre dans une de ces audiences pour observer comment sont reçues les personnes qui ont fui leur pays pour demander l’asile en France.
Dans le très chic quartier des antiquaires de Toulouse, dans un immeuble installé entre la préfecture et un palais militaire, se trouve la nouvelle chambre de la CNDA. Il est 10 heures quand nous y entrons. Devant la salle, plusieurs personnes sont déjà en train d’attendre l’audience du jour. La greffière ouvre la porte. La pièce est petite : trois bancs pour accueillir le public et, tout devant, celui où s’installeront les requérant⋅es. Ils et elles sont là pour contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) qui a refusé de leur accorder l’asile.
Depuis leur estrade, trois juges leur poseront des questions pour déterminer si ces personnes correspondent à la définition des réfugié⋅es donnée par la convention de Genève de 1951. Celle-ci prévoit qu’il faut, pour obtenir le statut de réfugié⋅e, avoir fui son pays d’origine et craindre d’y être persécuté⋅e en cas de retour en raison de l’un des critères suivants : « race, religion, nationalité, opinions politiques, ou appartenance à un certain groupe social ». Le portrait type du réfugié est une personne persécutée par un régime autoritaire.
Jusqu’à la fin des années 1970, cette définition pourtant assez restrictive n’a pas empêché l’obtention du statut par la quasi-totalité des personnes qui le demandaient. Celles-ci étaient cependant assez rares, parce qu’il était à l’époque relativement simple de séjourner légalement sur le territoire. Ainsi même les personnes qui auraient pu prétendre au statut ne le sollicitaient pas forcément. Quand la France a décidé de limiter l’immigration de travail et a commencé à fermer ses frontières, la demande de statut est progressivement devenue un des rares moyens d’obtenir un titre de séjour. Ainsi, les demandes d’asile sont passées de moins de 2 000 par an dans les années 1970 à plus de 150 000 aujourd’hui.
À partir des années 1980, les responsables politiques de tous bords rivalisent d’imagination pour restreindre l’accueil des étrangèr⋅es, accusées de tous les maux. Dans ce contexte, l’application stricte de la définition très individualiste de la qualité de réfugié⋅e permet d’écarter les personnes qui ne peuvent pas prouver qu’elles sont personnellement persécutées. Et ce, même si elles viennent d’une zone de conflit généralisée ou appartiennent à un groupe réprimé.
Devant nous, un jeune Kurde s’assoit sur le banc en face des trois juges, entouré de son avocat et d’une interprète. Installée à droite de l’estrade, la rapporteuse résume le dossier :
— Vous demandez la protection internationale parce que vous dites être en danger en raison de votre engagement politique en faveur du Parti démocratique des peuples (HDP). Vous venez d’une région kurde et vous appartenez à une famille engagée pour la cause kurde. L’Ofpra a rejeté votre demande de protection en considérant que vos déclarations n’ont pas permis de fonder votre engagement politique. Vous demandez l’annulation de cette décision et que vous soit reconnue la qualité de réfugié ou à défaut la protection subsidiaire.
Elle liste ensuite les bons et les mauvais points du dossier.
— L’entretien avec l’Ofpra donne à penser qu’il est effectivement un sympathisant du HDP au vu de sa connaissance du contexte politique. Son environnement familial est de manière avérée marquée par le militantisme pro-kurde. Mais sur son engagement, ses déclarations sont peu précises. Quelles ont été ses missions ? Quelles actions a-t-il menées pour le HDP ? Comment a-t-il été identifié par l’autorité turque ? Il n’y a pas non plus d’explication sur les conséquences du militantisme de sa famille sur sa situation personnelle.
L’entretien à l’Ofpra et l’audience à la CNDA sont marqués par le soupçon et la volonté de démasquer les « faux réfugiés », ceux et celles qui migreraient pour fuir la misère. Les juges de la CNDA soumettent les requérent⋅es à un feu roulant de questions pour débusquer les contradictions qui signaleraient des histoires inventées. La personne devra produire un récit très détaillé des circonstances qui l’ont amenée à quitter le pays. Que s’est-il passé d’assez grave pour l’obliger à partir ? Le président interroge minutieusement un requérant nigérian :
— Dans votre déclaration, il est question de l’élément déclencheur, une rixe en novembre 2020, contre une autre confraternité. C’était quel jour ?
— Le 14.
— Il y a un problème : vous n’étiez pas présent à cette rixe. Pourquoi les membres de la confraternité adverse vous en voudraient ?
— Je fais partie de la confrérie, ils le savent, ils me rechercheraient.
— Mais ça fait cinq ans que vous êtes dans la confrérie, cinq ans qu’il y a des rixes, cinq ans qu’il y a des morts ! Pourquoi celle-là en particulier vous ferait être recherché ?
— C’était la pire que j’ai vue !
— Oui, mais j’ai regardé sur Internet, il y en a une le 12 novembre, avec 18 morts. Vous dites que c’est la pire, mais là c’était la pire des pires. Donc ce n’est pas un argument.
Comme souvent, le président interroge le délai qui sépare l’« élément déclencheur » du départ avec suspicion, comme la marque d’une exagération du risque encouru :
— Vous n’êtes pas parti immédiatement après la rixe. Qu’est-ce que vous avez fait ?
— Je me suis caché chez l’homme qui m’a fait quitter le pays.
— De mi-novembre jusqu’à votre départ en janvier ?
— Oui, il m’a gardé chez lui.
— Et vous n’êtes pas sorti ?
— Il avait une grande maison.
— Qui était où ?
— À Benin City.
On suspecte même les requérant⋅es d’avoir falsifié les documents produits pour prouver leur situation. Quand un jeune Afghan présente une lettre de menace des Talibans dans son dossier, le président commente :
— Pour autant qu’elle soit vraie ! On ne peut jamais savoir…
Mais comment les juges seraient-ils à même d’évaluer l’immense variété des situations qui leur sont présentées ? La CNDA confronte les récits des requérant⋅es aux notes d’informations sur les pays concerné produites par son Centre de recherche et de documentation (Ceredoc). À l’audience, le président a mobilisé cette documentation pour mettre en doute la parole du requérant nigérian qui indiquait faire partie d’une confrérie :
— Vous avez parlé d’une cérémonie d’initiation pour intégrer cette confraternité. Pouvez-vous la décrire ?
— Le soir de mon entrée dans la confraternité, on m’a bandé les yeux et emmené dans la brousse. Ils ont mis le feu, j’étais nu, on m’a battu, je devais m’allonger et me rouler par terre. Je devais dire que j’étais fort, et à partir de ce moment-là je devenais un membre du groupe. Je devais jurer de ne jamais dévoiler ses secrets, même si j’étais arrêté par la police. J’ai prêté serment. Et on m’a fait boire du sang.
— D’où venait-il, ce sang ?
— Je ne sais pas. On m’a fait une marque.
L’homme montre une cicatrice sur son bras.
— Avec quoi a été faite cette entaille ?
— Une lame de rasoir.
Le président lui demande alors de venir lui montrer son pouce droit. Après l’avoir très minutieusement examiné, il déclare :
— D’après la documentation, dans les rites d’initiation des confraternités nigérianes, il y a une entaille sur le pouce droit et on fait boire le sang à la personne. Là il n’y a rien, donc ça ne colle pas.
Cette documentation n’est pas publique : les requérant⋅es et leurs avocat⋅es n’y ont pas accès. Elle fait régulièrement l’objet de critiques vives de la part de chercheur⋅es spécialistes des pays concernés, qui y dénoncent « inexactitudes » et « interprétations hâtives ou partiales », alors qu’elle a un poids considérable dans les audiences [1].
Au-delà de la traque du migrant économique, la figure du migrant dangereux tend à prendre de plus en plus de place dans les décisions de la CNDA et de l’Ofpra. Ce dernier est d’ailleurs rattaché au ministère de l’Intérieur depuis 2010. Depuis les attentats de 2015, le soupçon terroriste pèse sur toutes les personnes qui demandent l’asile. Aujourd’hui la police, l’administration pénitentiaire, la préfecture et la justice doivent transmettre à l’Ofpra et à la CNDA les informations sur les requérant⋅es laissant supposer l’existence « d’une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État [2] ».
Dans les faits, une foule d’informations sont communiquées qui n’ont rien à voir avec le terrorisme, comme le casier judiciaire ou les fichiers de police. Le simple fait d’avoir été arrêté sans qu’il y ait eu de poursuite peut figurer dans les dossiers de demande d’asile et porter préjudices aux requérant⋅es. En fait de menaces graves, une simple condamnation pour détention de produits stupéfiants peut amener à un rejet de la demande.
Et quand bien même son dossier serait exempt de tout antécédent judiciaire ou autre renseignement policier, la personne devra rassurer la Cour sur son mode de vie. Officiellement, la CNDA et l’Ofpra n’ont pas à évaluer l’intégration des personnes. Pour autant, quand un réfugié afghan met en avant le risque de persécution qu’il encourt dans son pays d’origine en raison de son « occidentalisation », le débat va glisser sur son adhésion à une certaine idée de la culture française et sa pratique de la religion, quoi qu’en dise le juge :
— Il ne s’agit pas d’évaluer votre intégration mais d’apprécier les risques que vous soyez désintégré à votre retour en Afghanistan. Je refuse de poser la question de la religion. En ce qui me concerne, vous pouvez prier autant de fois par jour que vous le voulez. Bon, est-ce que vous consommez de l’alcool ?
— Non.
— Vous avez une amie pakistanaise. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble ?
— 9 ou 10 mois.
— Ça commence à être stable, c’est très bien. Vous appartenez à l’ethnie pachtoune, est-ce que votre mère est au courant de cette relation hors mariage ?
— Oui.
— Comment est-ce qu’elle le prend ?
— Au début elle était un peu choquée. C’est une femme de la campagne. Mais ici, c’est comme ça que ça se passe, alors elle a accepté.
— [D’un air de doute] Ah, ce serait parce que c’est une « femme de la campagne »… Est-ce que ce ne serait pas plutôt à cause du code d’honneur pachtoune ? […] Et quand vous serez marié, si vous avez une fille et qu’elle a une relation avant mariage qu’est-ce que vous ferez ?
— Rien de spécial, c’est son choix personnel.
Le président est satisfait :
— Une fois j’ai eu comme réponse : « Je la tue, c’est contraire au code d’honneur pachtoune, je la tue. » Ou bien : « Non, pas de lapidation mais la prison oui. »
Quand vient le moment de la plaidoirie de l’avocate, elle ne fait pas dans la dentelle :
— Son profil est clairement occidentalisé ! Il aime visiter des églises et des châteaux. Certes, il ne boit pas mais il aime les films d’horreur et les jeux vidéos ! Il a le mode de vie d’un jeune de 25 ans. Son amie pakistanaise ne porte pas le voile, elle fait les études pour être infirmière. C’est une femme émancipée. Il a des amis français, étranger, musulman, catholique, athée. Même s’il ne boit pas, il sort dans les bars. Il se rend à des concerts, au cinéma. Il loue des films. Il a même vu la dernière palme d’or sur une strip-teaseuse de Brooklyn. Il a une passion pour les lieux historiques : Bordeaux, Carcassonne, Lourdes. Il célèbre les fêtes occidentales, et même Noël ! Il adore les décorations de Noël. Il a un rapport apaisé à la religion et aux femmes. Il vit au quotidien avec sa mère et ses sœur, il aide à la maison [3].
Les lois concernant l’immigration s’empilent depuis des décennies, rendant la vie des personnes concernées de plus en plus difficile. C’est celle du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration » qui a organisé la territorialisation de la Cour nationale du droit d’asile, c’est-à-dire l’ouverture de chambres dans plusieurs villes de France : Bordeaux, Lyon, Nancy, et donc Toulouse. Les pouvoirs publics viseraient ainsi des objectifs humanistes : rapprocher les requérant⋅es de leurs juges. De fait les personnes qui demandaient l’asile devaient jusque-là se rendre à Montreuil avec tous les frais de transport et de logement que ça impliquait. Mais la territorialisation aussi un outil d’accélération des procédures d’asile. D’ailleurs une autre mesure prévoit que, dans la plupart des cas, la situation des requérant⋅es soit examinée par un seul juge au lieu de trois. Sachant que depuis une dizaine d’années, la CNDA rejette déjà un tiers des demandes sans audience.
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur de l’époque, a été très clair sur l’objectif de cette accélération quand il a défendu cette loi devant le Sénat : pouvoir expulser plus rapidement en raccourcissant des procédures jugées trop longues.
« Pendant ce temps-là, cette personne aurait peut-être été embauchée par un patron voyou, parce qu’il faut bien qu’elle vive. Elle aurait peut-être eu l’occasion d’avoir accès au logement, ce dont nous reparlerons. Elle aurait peut-être eu accès à la santé, ce dont nous reparlerons aussi. Elle aurait peut-être fait des enfants sur le territoire national. Si tel avait été le cas et que cette personne s’était mariée, alors le ministre de l’Intérieur ne pourrait pas l’expulser [4]. »
Il est prévu que la chambre de la CNDA de Toulouse se prononce sur la demande de protection de 13 personnes par jour, dont la majorité n’obtiendra pas le statut de réfugié. En 2024 en effet, 80 % des recours ont été rejetés.
Pour ceux et celles qui voudraient rendre compte autour d’eux de la violence de ces audiences, elles se tiennent à la cour administrative d’appel (3 rue Montoulieu Saint-Jacques) et sont publiques, sauf demande de huis clos par le ou la requérante.
[1] « Comment est évaluée la dangerosité des situations pour les personnes demandeuses d’asile ? », tribune publiée dans Le Monde, 3 mai 2021.
[2] Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L512-2.
[3] Pour lire le récit de l’audience dans son intégralité : « Même Noël ».
[4] Discours de présentation de la loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration devant le Sénat, 6 novembre 2023, disponible sur www.senat.fr/seances/s202311/s20231106/s20231106002.html#section583.
*
Vous pouvez aussi écouter nos deux émissions de radio consacrées au droit d’asile : Ne pas donner asile. Épisode 1 : De la protection des réfugié⋅es à la protection de l’ordre public ; Épisode 2 : Les exilé⋅es face à la suspicion de la Cour nationale du droit d’asile.