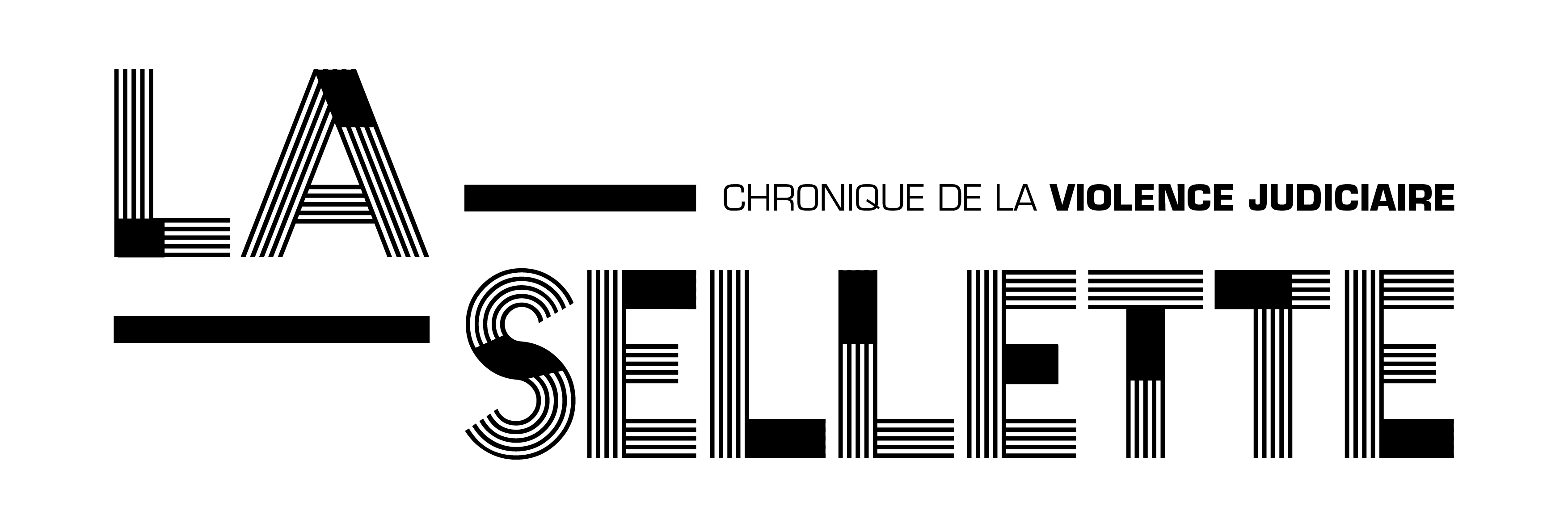Seconde partie de Histoire des comparutions immédiates (la première partie est en ligne ici). Cet article revient sur la généralisation du recours à cette procédure accélérée à partir des années 1980.
Loi « Sécurité et liberté » : une tentative avortée pour faire sauter le verrou du flagrant délit
En 1977, l’année où il devient garde des Sceaux, Alain Peyrefitte coécrit un rapport qui dresse un portrait outrageusement sombre de la société française de l’époque :
Longtemps tenue en marge, la violence s’est installée au cœur de la Cité. Pas encore en maîtresse, mais ce temps peut venir. Si rien n’est fait pour répondre à l’interpellation qu’elle nous adresse, ce temps viendra sans doute… Un sentiment d’insécurité générale est apparu, qui lui-même peut engendrer la violence, dans une société où la règle du droit n’entraîne plus un consensus général, et où certains sont tentés de se faire justice eux-mêmes.
Cet inquiétant diagnostic va tout naturellement le conduire à élaborer un projet de loi répressif, connu sous le nom de « Sécurité et liberté ». Lors de sa présentation devant l’Assemblée nationale, il utilisera d’ailleurs une expression nébuleuse, qui a connu depuis une belle postérité :
On a souvent opposé au cours des dernières semaines ces deux notions de sécurité et de liberté. Certains feignent de penser que tout renforcement de la sécurité se fait aux dépens de la liberté et qu’en revanche il faut se résoudre à payer toute extension des libertés individuelles par une croissance de l’insécurité. Dieu merci, il n’en est rien ! Le gouvernement ne vous propose pas de résoudre la quadrature du cercle. Liberté et sécurité sont solidaires : voilà le vrai. La sécurité est la première des libertés.
Entre autres mesures répressives, cette loi remplace l’ancienne procédure de flagrants délits par une procédure de « saisine directe » : le procureur de la République peut saisir le tribunal le jour même si les charges déjà réunies paraissent suffisantes et lorsque la peine prévue par la loi n’excède pas cinq ans d’emprisonnement.
On remarque qu’il ne s’agit plus de juger une personne prise la main dans le sac : le ministère public peut désormais utiliser cette procédure pour toute affaire qu’il estime en état d’être jugée.
Si la notion de flagrance était déjà floue, la disparition de ce critère permet de juger en procédure rapide des faits anciens. Ainsi, même un an après les faits, un individu pourra être placé en garde à vue, jugé 48 h plus tard et dormir le soir même en prison. Il sera présenté devant le tribunal après plusieurs mois d’investigations à charge dont il ignore tout. La défense n’aura, elle, que quelques heures pour se préparer et tenter de réunir des pièces en faveur de l’accusé. Que les faits soient anciens ou récents, que l’affaire soit simple ou complexe, peu importe dès lors qu’aux yeux de l’accusation elle est « en état d’être jugée ». Les justifications avancées un siècle plus tôt pour recourir à une procédure peu respectueuse des droits sont oubliées.
Pourtant, comme en 1863, les tenants de ce projet répressif mobilisent un argument humaniste : la diminution du recours à la détention provisoire. Peyrefitte lui-même, devant l’Assemblée nationale, donne des leçons d’altruisme :
La justice ne doit pas être expéditive : mais qu’elle traîne interminablement, voilà qui n’est pas tolérable. Une lenteur excessive a de graves effets négatifs. Elle remplit les prisons de prévenus en détention provisoire, mais pour lesquels, souvent, le provisoire dure longtemps. […] Et j’admire que le confort intellectuel de certains juristes qui font profession de se battre pour les droits de l’homme n’en soit nullement dérangé. Quant à ceux d’entre eux, bien rares, qui s’en préoccupent, ils n’ont jamais rien proposé pour qu’on en sorte !
Peu émue par ces effets de manche, la gauche dénonce, dans un bel ensemble, ce projet de loi. Robert Badinter est catégorique : « Ce projet est mauvais, ce projet est dangereux. »
Le projet de loi est finalement adopté et entre en vigueur au début de l’année 1981. L’opposition ne désarme pas pour autant, et François Mitterrand, pendant la campagne présidentielle de 1981, promet d’abroger cette « loi liberticide » s’il est élu. De fait, immédiatement après son élection quelques mois plus tard, il suspend les mesures liées à la saisine directe et organise une commission qui prépare l’abrogation de la loi.
En revanche, ceux qui avaient nourri l’espoir d’une disparition des procédures pénales accélérées seront déçus. Devenu garde des Sceaux, Robert Badinter, lors de la présentation de son projet de réforme de la justice à l’Assemblée nationale, affirme :
Il n’est pas possible d’espérer supprimer de la procédure pénale française, telle qu’elle fonctionne réellement, une procédure rapide. Le problème n’est pas celui de l’existence d’une procédure rapide mais celui des garanties accordées aux justiciables dans le cadre d’une telle procédure.
La loi du 10 juin 1983 maintient donc une procédure accélérée : elle sera baptisée « comparution immédiate ». Pour ce qui est des garanties, elle ne sera applicable qu’aux flagrants délits réprimés par une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement.
Le verrou saute : l’abandon du critère de flagrance
Quand les élections législatives de 1986 portent à l’Assemblée nationale une majorité de droite, François Mitterrand nomme Jacques Chirac, président du RPR, au poste de Premier ministre. Le nouveau gouvernement s’empresse de remodifier le champ d’application de la comparution immédiate : le critère de flagrance est à nouveau supprimé pour les délits passibles d’une peine comprise entre deux et cinq ans d’emprisonnement (il est maintenu est revanche pour les délits passibles d’un an de prison).
Pour justifier devant l’Assemblée nationale l’adoption de cette mesure répressive, le garde des Sceaux Albin Chalandon évoque, en vrac, « une société qui perd ses valeurs », « la société de consommation », « la faillite des méthodes éducatives », « la désintégration de la famille », « l’immigration clandestine » et « la drogue » :
Il semble que certains jeunes, ceux qui s’adonnent à la drogue par exemple, ne soient plus armés pour faire face au moindre souci, au moindre problème de l’existence. Dès que celle-ci leur résiste – et nous savons tous, hélas, que c’est le propre de la vie – les voici qui se réfugient de plus en plus nombreux dans le vol ou la drogue.
Sans doute tétanisée par cette avalanche de calamités, la gauche ne s’oppose que timidement à cette réforme. Même si, bien sûr, on entend les protestations d’usage à l’Assemblée nationale :
Les défauts de cette procédure sont fondamentaux. En effet, l’infraction y prend le pas sur la personnalité du délinquant. Les éléments de preuve sont uniquement de nature policière et on a vu ce que cela valait. La défense est assurée par de jeunes avocats, de permanence le plus souvent, et qui, malgré leur dévouement et leur disponibilité, auxquels il convient de rendre hommage, n’ont forcément qu’une connaissance imparfaite du dossier et de celui qu’ils défendent. Le critère de flagrance avait au moins l’avantage de limiter de façon objective et étroite les affaires susceptibles d’être jugées dans ces conditions alors que la proximité des faits assurait mieux la certitude de la peine. (Jean-Pierre Michel, PS.)
La loi est adoptée sans difficulté. Et le critère de la flagrance, avancé pendant plus d’un siècle comme un garde-fou face à une procédure peu respectueuse des droits, tombe définitivement. La gauche n’y reviendra plus.
1995 : une première élévation du plafond
Depuis la loi de 1983, seuls les délits passibles de deux à cinq ans de prison (un an en cas de flagrant délit) pouvaient être poursuivis en comparution immédiate. En 1995, le gouvernement Balladur fait passer le plafond des peines de prison encourues de cinq à sept ans.
Cette modification est présentée comme une harmonisation de la procédure avec le relèvement des peines qu’a opéré le nouveau Code pénal.
De fait le Code pénal mis en chantier par Badinter et entré en vigueur en 1994 réprime plus sévèrement certaines infractions, notamment par la création de nouvelles circonstances aggravantes. Auparavant un vol en réunion dans le métro, par exemple, était considéré comme un vol aggravé par une seule circonstance, la réunion, et était passible de cinq ans d’emprisonnement. Le nouveau Code pénal considère ce même fait comme un vol aggravé par deux circonstances (la réunion et le fait qu’il soit commis dans un moyen de transport) et le rend passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement.
Il en résulte que des faits qui pouvaient auparavant faire l’objet d’une comparution immédiate ne pourraient plus être poursuivis selon cette procédure si l’on n’avait pas étendu son champ d’application aux infractions passibles de sept ans de prison.
Cet ajustement répressif passe inaperçu, le feu des critiques, nourri notamment par le Syndicat de la magistrature, se concentrant sur l’extension du recours à des procédures correctionnelles jugées par un seul juge.
Les années 2000 : l’emballement sécuritaire
Pendant la campagne électorale pour les élections présidentielles de 2002, « l’insécurité », particulièrement dans les « cités », est au cœur du débat politique. Jacques Chirac multiplie les interventions plus ou moins nuancées sur le sujet :
Le 14 juillet dernier, j’ai exprimé une fois de plus mon inquiétude devant la montée de l’insécurité. Je l’ai fait parce que la violence est en train de changer le visage de notre République. Elle crée la peur. Elle met en cause les fondements mêmes de la vie en société. Et la situation continue de s’aggraver. […] Ce que nous constatons aujourd’hui n’est pas un simple dérèglement aux marges de la société. Plus personne en France n’est à l’abri.
Élu face à Jean-Marie Le Pen, il choisit Nicolas Sarkozy à l’Intérieur pour mettre en œuvre une politique de lutte contre la délinquance. Celui-ci n’aura d’ailleurs de cesse d’empiéter sur les plates-bandes du ministère de la Justice [1]Sa loi sur la sécurité intérieure, par exemple, réformant en profondeur la procédure pénale sous la tutelle du ministère de l’intérieur et non de la justice. « Le ministère de la … Continuer la lecture.
Aiguillonné par cet envahissant collègue, le garde des Sceaux Dominique Perben ficelle en quelques mois une importante réforme de la justice, adoptée en urgence en septembre. La loi d’orientation et de programmation pour la justice, dite « loi Perben I », fait sa fierté ; il en parle en toute simplicité comme d’une « chance historique d’un renouveau de la justice au service des Français ».
Entre autres choses, cette loi modifie une nouvelle fois le périmètre des comparutions immédiates, de manière à y faire entrer, comme l’explique le garde des Sceaux, les « infractions à la législation sur les stupéfiants » et les « destructions par substances incendiaires ». L’exposé des motifs est clair : la loi est orientée vers la délinquance de banlieue : drogue et voitures brûlées, thèmes si abondamment traités par les médias au cours des années précédentes [2]À tel point que de nombreux observateurs avaient reproché aux JT des grandes chaînes d’avoir accordé une couverture démesurée à l’insécurité en France, en particulier dans les banlieues, … Continuer la lecture.
La loi relève le plafond des peines encourues à dix ans de prison. À l’autre bout du spectre, la comparution immédiate peut désormais s’appliquer aux délits passibles de 6 mois d’emprisonnement en cas de flagrance (un an précédemment) : ce changement permet notamment de passer en CI les faits d’outrage et de rébellion, à l’époque passible de six mois [3]Aujourd’hui l’outrage est passible d’un an d’emprisonnement et la rébellion de deux ans… La manière dont les infraction commises contre les forces de l’ordre sont punies de plus en plus … Continuer la lecture.
Désormais l’immense majorité des délits peut donc être jugée en comparution immédiate.
C’est une loi incomparablement plus répressive que celle de Peyrefitte. Pourtant elle ne déclenche plus qu’une mobilisation en demi-teinte de la gauche, notamment parce que vingt ans ont passé et que les socialistes ont pris le tournant sécuritaire depuis la fin des années 1990. Lors d’un colloque organisé par son gouvernement en 1997 à Villepinte, Lionel Jospin annonçait par exemple :
Il n’y a pas de choix entre la liberté et la sécurité. Il n’y a pas de liberté possible sans la sécurité.
Cette formule permet de mesurer le chemin parcouru depuis l’époque où le socialiste Pierre Mauroy affirmait à Alain Peyrefitte que :
Pour la droite, la première liberté, c’est la sécurité. Nous inversons la proposition : pour nous, la première sécurité est la liberté.
Terrifié à l’idée d’être accusé de laxisme, le PS se cantonne à une opposition un peu tiède – dite « constructive » –, en faisant surtout des remarques techniques. Le socialiste Jean-Pierre Sueur est très clair : « Nous ne devons pas avoir l’air d’être systématiquement contre, car nous sommes partisans d’une plus grande sécurité et d’une justice plus rapide. »
*
Au terme de cette longue évolution, le nombre d’affaires traitées en comparution immédiate a explosé : de 20 000 en 1970 (4 % du total des poursuites), on est passé à 47 000 en 2019 (près de 8 % du total des poursuites).
Alors qu’un des principaux motifs avancés pour généraliser cette procédure très attentatoire aux droits de la défense a toujours été de lutter contre la détention provisoire, celle-ci ne cesse d’augmenter, largement alimentée d’ailleurs par cette procédure elle-même.
Par ailleurs, la comparution immédiate est aujourd’hui la procédure qui envoie le plus de gens en prison, alimentant une surpopulation carcérale qu’aucune construction de prison ne parviendra à endiguer.
Notes
| ↑1 | Sa loi sur la sécurité intérieure, par exemple, réformant en profondeur la procédure pénale sous la tutelle du ministère de l’intérieur et non de la justice. « Le ministère de la Justice a disparu, il est devenu la chambre d’enregistrement du ministère de l’Intérieur », s’alarme Bruno Marcuse, le président du Syndicat des avocats de France (SAF). |
|---|---|
| ↑2 | À tel point que de nombreux observateurs avaient reproché aux JT des grandes chaînes d’avoir accordé une couverture démesurée à l’insécurité en France, en particulier dans les banlieues, au point d’avoir favorisé la qualification d’un candidat de l’extrême droite au second tour de l’élection présidentielle d’avril-mai 2002. |
| ↑3 | Aujourd’hui l’outrage est passible d’un an d’emprisonnement et la rébellion de deux ans… La manière dont les infraction commises contre les forces de l’ordre sont punies de plus en plus sévèrement fera l’objet d’un prochain article thématique. |